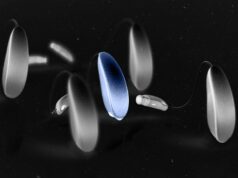Dans le but de freiner la propagation du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, les experts en santé publique ont fait pression pour un déploiement rapide et efficace du vaccin. Cependant, certains membres du public ont hésité à se faire vacciner. Que s’est-il passé, et y a-t-il quelque chose que les communicateurs scientifiques continuent de se tromper sur l’hésitation à la vaccination ?
Des millions de personnes dans le monde ont maintenant reçu un vaccin contre le COVID-19, mais pour beaucoup, la décision n’a pas été facile – en effet, certaines personnes n’ont pas encore accepté un vaccin contre le COVID-19, même s’il leur est disponible.
Certains chercheurs ont nommé ce phénomène « réticence à la vaccination » — le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) définit comme le « retard dans l’acceptation ou le refus des vaccins malgré la disponibilité des services de vaccination ».
Mais qu’est-ce qui rend les gens incertains quant à l’acceptation d’un vaccin donné ? Et la réticence à la vaccination est-elle quelque chose que les communicateurs scientifiques peuvent aider à résoudre ?
Les théories sur les raisons des inquiétudes liées aux vaccins abondent, et elles peuvent toutes détenir une part de vérité. Certains chercheurs supposent que ce qui fait hésiter les gens à accepter ou non un vaccin, c’est le manque d’accès à des informations précises et complètes.
D’autres disent que tout se résume à la propagation de dis- et
Cela est dû à une longue histoire d’expérimentation médicale et d’éclairage au gaz vécue par cette communauté, ainsi qu’à des expériences actuelles de racisme et de discrimination lors de la tentative d’accès aux soins de santé.
Mais le manque de confiance dans les scientifiques et les autorités de santé publique se propage beaucoup plus loin et plus profondément, et il peut être un facteur clé de la réticence à la vaccination dans le monde.
Dans cet épisode du podcast In Conversation, nous avons parlé avec Pr Maya Goldenbergprofesseur de philosophie à l’Université de Guelph en Ontario, Canada, et auteur de Hésitation face aux vaccins : confiance du public, expertise et guerre contre la science.
Nous avons également été rejoints par le journaliste Aaron Khemchandani, étudiant à la maîtrise en communication scientifique à collège impérial de Londres au Royaume-Uni, et qui a étudié le phénomène de méfiance à l’égard de la science.
Cette fonctionnalité est basée sur un enregistrement édité et raccourci de la discussion présentée dans notre podcast. Vous pouvez écouter le podcast dans son intégralité ci-dessous ou sur votre plateforme préférée.
Dans son livre, la professeure Goldenberg explique que l’hésitation face aux vaccins est un phénomène à spectre complet – les gens peuvent se sentir vaguement incertains quant à savoir si un vaccin est sûr et efficace ou très anxieux quant à ses effets potentiels.
Pourtant, le concept lui-même, explique-t-elle, est un concept assez nouveau sur lequel les experts en santé publique doivent se concentrer – historiquement, les institutions de santé publique se sont concentrées sur l’enregistrement des taux de refus de vaccin plutôt que sur ce qui fait que les gens hésitent à accepter les vaccins, quel que soit leur résultat final. décision.
Cependant, comprendre ce qui motive la réticence à la vaccination est beaucoup plus utile lorsqu’il s’agit de promouvoir la santé publique, affirme le professeur Goldenberg. Tout d’abord, écrit-elle, comprendre les appréhensions des gens à propos des vaccins et apaiser ces craintes peut aider à stimuler l’adoption des vaccins.
Deuxièmement, le fait de ne pas communiquer efficacement avec les gens sur ce qui les rend hésitants face à la vaccination peut en fait les décider à la refuser.
Alors, quels sont les facteurs qui motivent la réticence à la vaccination ? La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’un d’entre eux : de nombreuses personnes dans le monde ne font pas confiance aux autorités sanitaires nationales et internationales, souvent pour des raisons complexes.
Dans notre dernier épisode de podcast, Aaron Khemchandani a donné la situation dans Hong Kong à titre d’exemple, expliquant que la méfiance à l’égard des institutions gouvernementales a initialement conduit à une faible utilisation du vaccin COVID-19. Cependant, l’augmentation qui a suivi des cas de COVID-19 a finalement renversé le scénario, a noté Aaron.
« [P]es gens ont décidé que le vaccin était important pour protéger la communauté, et la communauté est l’une des valeurs qui, en particulier en Asie de l’Est, est largement privilégiée au sein de la population. Dès le début de la pandémie, [in] Le port du masque à Hong Kong était répandu, car les masques […] protéger les autres de vous, alors les gens voulaient protéger leurs proches », a-t-il expliqué.
« [T]chapeau vient de montrer comment [much] Hong Kong attachait de l’importance à la protection de la société au sens large, et les vaccins en sont donc devenus une partie lorsque [COVID-19] le nombre de cas a commencé à augmenter », a ajouté Aaron.
Bien que le résultat soit ici positif, pour le professeur Goldenberg, la résistance initiale aux vaccins à Hong Kong était très révélatrice de la manière dont la relation des gens avec les institutions peut influencer leur opinion et leur confiance dans les interventions médicales.
« Ce qui me ressort vraiment de ce récit de Hong Kong », nous a-t-elle dit, « c’est la façon dont la confiance générale dans le gouvernement et les structures sociales influence les opinions sur les vaccins ».
« [T]Cela va à l’encontre de la pensée courante selon laquelle les personnes qui ne se font pas vacciner ne comprennent pas la science, ou ont une sorte de rupture cognitive qui les empêche de faire ce qu’il faut. Au lieu de cela, il y a beaucoup de recherches en sciences sociales, pas seulement à Hong Kong, mais dans de nombreux pays, avant et pendant le COVID, montrant que la confiance d’une personne dans le gouvernement, en particulier [in a] gouvernement face à une crise est largement corrélé à votre probabilité de vous faire vacciner. […] Vous devez faire confiance au système qui vous apporte des vaccins, afin d’être prêt à participer à [vaccination programmes].”
– Pr Maya Goldenberg
« Il ne s’agit pas de comprendre la science, […] il s’agit de faire confiance au processus scientifique et réglementaire qui nous apporte des vaccins et de nous dire que [they are] sûr et efficace, et quelque chose que nous devrions [accept]. Si vous ne faites pas confiance au système, vous ne ferez pas confiance au vaccin », a-t-elle souligné.
Bien qu’il puisse être utile de penser à l’hésitation plutôt qu’au refus lorsqu’il s’agit de comprendre les facteurs qui influencent la vaccination, tout le monde n’est pas d’accord pour dire que le terme « hésitation à la vaccination » est utile dans tous les contextes.
Pour certains, il s’agit d’un terme impropre qui ne reconnaît pas le fait que les institutions médicales elles-mêmes sont parfois responsables de la faible utilisation des vaccins dans la communauté.
« [T]il y avait là de sérieuses plaintes politiques concernant l’utilisation du terme alors que, disons, il n’y avait pas assez d’accès [to] vaccins [among] groupes marginalisés », nous a dit le professeur Goldenberg.
« Et les politiciens diraient: » Eh bien, ils hésitent simplement à se faire vacciner. Et les gens au sein de ces communautés diraient, ‘eh bien, c’est [a] utilisation paresseuse du terme, nous avons un problème d’accès, nous n’avons pas de problème d’hésitation à la vaccination, et ils utilisent [the term] comme une diapositive pour la non-responsabilisation, pour le manque d’infrastructures, pour le manque de soutien pour les personnes qui ne sont pas pleinement intégrées au système », a-t-elle expliqué.
En fait, aux États-Unis et ailleurs dans les pays occidentaux, les personnes qui ont été touchées de manière disproportionnée par le COVID-19 tout au long de la pandémie sont celles appartenant à des communautés historiquement marginalisées, telles que les migrants, les Noirs et les Hispaniques, et les personnes sans papiers.
Souvent, les personnes appartenant à ces communautés travaillent dans des rôles en contact direct avec les clients qui augmentent leur risque d’infection, peuvent être confrontées à des conditions de vie moins sûres telles que logement surpeupléet peuvent avoir un accès limité ou inexistant à des soins de santé en temps opportun.
Même lorsqu’elles ont accès aux vaccins, les personnes appartenant à des groupes marginalisés peuvent encore hésiter à les prendre. Pourquoi donc?
Selon des recherches portant sur la réticence à la vaccination chez les adultes noirs aux États-Unis, leurs opinions sur la vaccination sont «liées au long héritage du racisme systémique dans le système de santé américain».
A la fois historique et récent Expériences personnelles de discrimination dans les soins de santé ont rendu de nombreux adultes noirs moins susceptibles de faire confiance au système de santé et aux prestataires de soins de santé qui ne comprennent pas leurs besoins et peuvent souvent perpétuer des stéréotypes nuisibles.
« Je pense [the experience of current and historic discrimination is] un moteur majeur de la réticence à la vaccination », nous a dit le professeur Goldenberg. « Je pense que c’était comme ça avant COVID, mais c’est devenu en quelque sorte plus visible pour le public [during the pandemic.”
“I remember near the beginning of [the] COVID [pandemic]ils avaient fait beaucoup de recherches par sondage, lorsque les vaccins COVID sont devenus disponibles, [asking] « allez-vous vous faire vacciner ? », se souvient-elle, « et il a été traité comme une surprise que les groupes marginalisés qui souffraient le plus du COVID, [the] personnes qui ne pouvaient pas travailler à domicile, vivaient dans des conditions de logement qui [weren’t] propice à la distanciation sociale, […] étaient les moins susceptibles de se faire vacciner.
« Et cela n’aurait pas dû être traité comme un choc, car je pense que les connaissances sur la méfiance à l’égard des soins de santé et du gouvernement parmi les communautés marginalisées étaient déjà là. C’est juste que les liens n’avaient pas été établis entre la prise de décision en matière de soins de santé et les expériences de marginalisation. La vérité, c’est que nous n’avons même pas besoin de remonter aussi loin dans des études de cas célèbres, comme le
Études sur la syphilis de Tuskegee — vous pouvez regarder les expériences de […] les gens dans le domaine de la santé aujourd’hui pour comprendre pourquoi ils ne sont pas en première ligne là-bas […]”– Pr Maya Goldenberg
Il est difficile de nier que la réticence à la vaccination est également compliquée par la mésinformation et la désinformation délibérées diffusées par des influenceurs aux agendas douteux.
Dans notre discussion, Aaron a mentionné l’impact disproportionné de la soi-disant Douzaine de désinformation – en 2021, le Center for Countering Digital Hate (CCDH) a publié les résultats d’une enquête qui a révélé que la plupart de la désinformation diffusée en ligne sur les vaccins COVID-19 à l’époque provenait de pas plus de 12 influenceurs sociaux actifs.
À l’ère numérique d’aujourd’hui, les informations altérées peuvent se propager très rapidement et faire beaucoup de mal. Cependant, tout en reconnaissant l’impact de la mésinformation et de la désinformation, le professeur Goldenberg a averti que nous devons nous méfier de blâmer le manque de confiance dans les vaccins exclusivement sur les mauvaises informations qui circulent facilement en ligne.
Il y aura toujours de mauvais acteurs sociaux qui répandent des mythes sur la santé, a-t-elle noté, et le simple fait de démystifier ces mythes encore et encore ne suffira pas à restaurer la confiance dans les établissements de santé, a-t-elle soutenu.
Le professeur Goldenberg pense également que certaines personnes peuvent être attirées par ces mauvais acteurs précisément parce qu’ils se placent dans le rôle de combattants contre un système oppressif – et c’est à cela que nous devons nous attaquer.
« [T]chapeau, pour une raison quelconque, résonne avec beaucoup de gens et de gens qui ont l’expérience de [how] ce système leur fait défaut – le rêve américain n’est pas quelque chose qu’ils estiment être à leur portée. Nous devons donc examiner le type de structures sociales qui créent ce niveau d’insatisfaction », a-t-elle souligné.
«Je regarde tout le temps passé à démystifier les mythes propagés par ces désinformateurs, et c’est presque hors de propos. Ce n’est pas que nous devrions laisser cette désinformation s’attarder […] Mais le fait est que ça va juste passer d’un [source] à un autre, vous fermez une source, une autre s’ouvrira parce qu’il y a un appétit pour elle. Vous démystifiez un mythe, c’est OK, un autre apparaîtra à sa place parce que les gens recherchent ce genre de débouché. […] [W]ça fait mal qu’ils sentent qu’ils veulent le placer sur quelque chose, et le placer sur ce genre de théories de désinformation et de complot [is] une façon de donner un sens à tout […]”
– Pr Maya Goldenberg
Donc, si un manque de confiance entre le public et les experts et organisations de la santé est le principal moteur de la réticence à la vaccination, comment pouvons-nous rétablir cette confiance ?
Des recherches récentes suggèrent que ce qui est le plus important pour les scientifiques, les organisations et les individus, c’est avant tout de communiquer avec empathie.
« Il y a eu de bonnes recherches démontrant que la façon de parler aux gens des vaccins est, tout d’abord, de ne pas essayer de les convaincre du contraire, et de ne pas leur expliquer les faits », a déclaré le professeur Goldenberg.
« Une approche sympathique est ce qui fonctionne, vous devez les écouter, écouter ce qu’ils ont à dire, essayer de ne pas porter de jugement à ce sujet – c’est parfois difficile à faire parce que nous sommes tous un peu fatigués et aimerions que les choses se passent. » aller un peu plus facile. Mais la meilleure chose à faire est d’écouter ce qu’ils ont à dire, de ne pas répondre avec une approche factuelle […] mais [instead] posez plus de questions et essayez de découvrir d’où viennent les doutes [lies]. Il pourrait y avoir des éléments concrets de désinformation, vous pouvez peut-être y faire face. Mais cela doit être fait de manière respectueuse, de la même manière que vous voudriez qu’on vous adresse la parole à quelqu’un qui n’est pas d’accord avec vous.
– Pr Maya Goldenberg
« Il s’agit plus d’essayer[ing] pour les rencontrer sur un terrain d’entente », a-t-elle noté.
Les mandats de vaccination peuvent pousser certaines personnes à se faire vacciner à court terme, mais à long terme, ils ne feront pas grand-chose pour signaler la confiance entre le public, le gouvernement et les organisations de santé, a également souligné Aaron.
« [Goverment-mandated restrictions] a augmenté le taux de vaccination, mais n’a rien fait pour rétablir la confiance entre les citoyens et le gouvernement, parce que cela a été fait en quelque sorte par nécessité et par peur, par opposition au partage de valeurs avec les responsables gouvernementaux et leur plan de réussite dans [the COVID-19 pandemic], » il expliqua.
Aaron était d’accord avec le professeur Goldenberg sur le fait que l’empathie est la clé, et les communicateurs scientifiques doivent changer la façon dont ils abordent la réticence à la vaccination pour donner la priorité aux individus et à leurs expériences :
« Je pense que la chose la plus importante est de trouver un terrain d’entente, juste pour trouver des valeurs partagées, comprendre les gens, les comprendre en tant que personnes, par opposition à simplement [thinking of them as] statistiques, […] comprendre le contexte historique, faire preuve d’empathie.